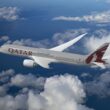En Tanzanie, le jour de l’indépendance ne s’annonce pas comme une célébration, mais comme un miroir des tensions qui fracturent le pays. Alors que l’opposition appelle à descendre dans la rue ce mardi pour dénoncer la répression qui a suivi les élections d’octobre, les autorités, elles, somment la population de rester chez elle, brandissant la menace d’un prétendu « coup d’État ». Un schéma devenu tristement familier dans une région où la contestation est trop vite criminalisée.
Le gouvernement tanzanien, sûr de sa force, a déployé d’importants dispositifs sécuritaires dans les grandes villes. Un message clair : la rue n’aura pas le dernier mot. Pourtant, les chiffres avancés par l’ONU sur les violences postélectorales — des centaines de morts — montrent que c’est précisément cette logique de confrontation qui maintient le pays dans un état de crispation permanente. Les Nations Unies ont beau appeler à lever l’interdiction de manifester et à bannir l’usage excessif de la force, leurs mises en garde peinent à trouver un écho dans un pouvoir qui se défend derrière une légitimité électorale contestée.
La réélection de la présidente Samia Suluhu Hassan, avec près de 98 % des voix, a laissé un goût amer à une opposition marginalisée et à une partie de la population qui n’y voit qu’un simulacre démocratique. Le taux, à lui seul, interroge. Il renvoie à ces chiffres écrasés qui, partout, trahissent davantage la fragilité d’un régime que sa solidité.
En ce jour symbolique, l’enjeu dépasse donc la manifestation annoncée. Il touche à la capacité de la Tanzanie à renouer avec une vie politique pluraliste, à entendre les voix dissidentes et à reconstruire la confiance entre gouvernés et gouvernants. Refuser la rue ne suffira pas à éteindre la colère. La question, désormais, est de savoir si le pouvoir choisira l’apaisement ou s’il s’enfermera encore davantage dans une démonstration d’autorité qui ne peut mener qu’à de nouvelles fissures.