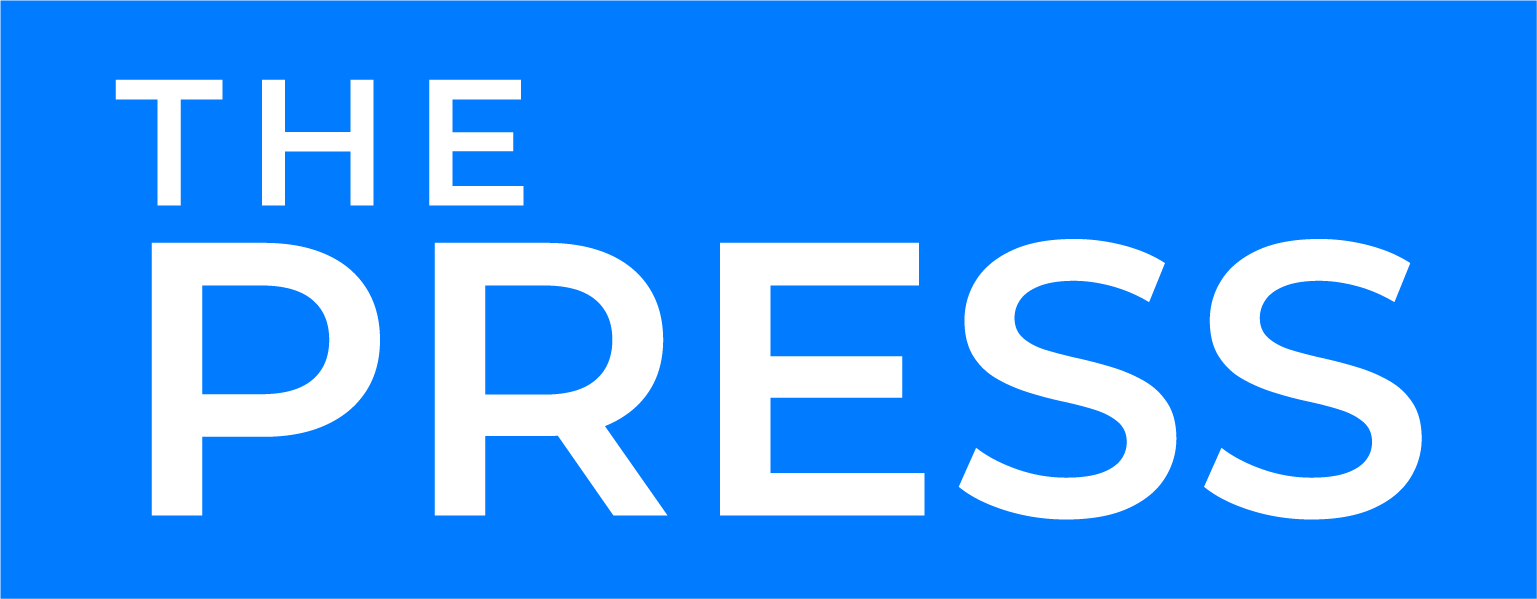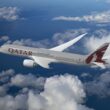Par Dr Ahmed Azough – Professeur et directeur de master en intelligence artificielle à Paris
Par un matin doux de l’automne parisien, la lumière du soleil caressait les marches de la Grande Mosquée de Paris, où se mêlent architecture marocaine, chaire égyptienne, fresques françaises et administration algérienne. Une alchimie étrange qui soulève bien des questions chez les Maghrébins. La Grande Mosquée de Paris est-elle française, marocaine ou algérienne ?
C’est dans ce lieu que j’avais choisi de retrouver mon ami Lotfi, un Algérien avec qui je partage un passé commun, et d’innombrables désaccords.
Cette fois, Lotfi tenait un livre sur le patrimoine maghrébin, rempli de coupures de presse et de photos. Nous nous sommes assis sur les marches après la prière d’Asr, profitant du jardin andalou de la mosquée, du chant mélodieux des oiseaux glissant entre les branches de jasmin, tel un air andalou réveillant la mémoire de la pierre et de l’eau.
Lotfi me lança un sourire un peu amer, teinté d’agacement, puis dit :
– Ahmed, aujourd’hui je ne parlerai pas de politique, ni du Sahara, ni du gaz, ni même de normalisation… Je veux parler d’un autre sujet sensible : le patrimoine. Voulez-vous vraiment vous approprier tout ? Le caftan ? Le zellige ? Le couscous ?! Tout devient marocain chez vous ! Même le raï et la melfa n’ont pas échappé à vos mains !
J’ai souri calmement en réajustant mon écharpe :
– Lotfi… Laisse-moi te parler franchement. La culture fait partie de l’identité, certes, mais peut-on vraiment la transformer en champ de bataille ?
Et j’ai poursuivi :
– La culture, ce n’est pas seulement une propriété, c’est une richesse partagée, une expérience vécue ensemble, le reflet des peuples qui interagissent, s’influencent, se croisent.
J’ai ajouté d’un ton plus posé :
– Ce qui me peine, Lotfi, c’est que plutôt que de nous réjouir de nos ressemblances, de nos danses ou nos habits similaires, nous nous accusons mutuellement. Au lieu de célébrer nos affinités, nous nous lançons dans une course pour prouver qui a inventé quoi en premier. Comme si nous n’avions jamais été deux peuples imbriqués, partageant coutumes et traditions. La culture ne connaît pas les frontières tracées par le colonisateur, elle voyage comme les oiseaux. Deux pays voisins partageront naturellement une grande partie de leur patrimoine culturel, comme on le voit partout dans le monde.
Lotfi acquiesça puis dit calmement :
– Tu as raison, Ahmed. Récemment, j’ai écouté une musique traditionnelle chinoise qui ressemblait étrangement à certains airs amazighs algériens. Cela m’a donné un sentiment de proximité culturelle. Je ne comprends pas pourquoi nous, les frères maghrébins, refusons de voir nos cultures proches les unes des autres.
Je lui ai répondu en baissant la tête :
– Je ne crois pas que ça ait toujours été comme ça, Lotfi. Les Marocains ont grandi en fredonnant Dahmane El Harrachi. Les Algériennes adorent la beauté du caftan marocain. Et depuis toujours, des maîtres artisans marocains du zellige et du plâtre sont venus restaurer les mosquées en Algérie. Ce climat conflictuel n’est apparu que récemment, alimenté par la rivalité croissante entre nos deux pays.
Lotfi m’interrompit :
– Mais, Ahmed, ce n’est pas juste une rivalité. C’est un vrai besoin de connaître l’origine de notre patrimoine et d’en être fier. N’y a-t-il pas des caftans et du zellige en Algérie comme au Maroc ? Pourquoi alors vous les appropriez-vous ?
Je répondis franchement :
– Lotfi, je ne nie pas qu’il existe des caftans à Tlemcen et à Alger, ni du zellige dans certains lieux comme au palais El Mechouar. Mais revendiquer un patrimoine ne dépend pas seulement de sa présence. On fête Halloween en France comme à New York, mais tout le monde sait qu’il est américain. Il y a un patrimoine originel et un patrimoine secondaire.
J’ai poursuivi calmement :
– Le caftan est présent au Maroc depuis l’époque mérinide et saadienne. Il y a évolué pour devenir un symbole royal, un habit de fête porté dans tout le pays. Depuis l’enfance, les Marocains sont baignés dans la culture du caftan, de la djellaba, des boutons en fil de soie, des broderies… On accompagne nos mères chez le tailleur pour chaque fête. Le caftan fait partie intégrante de l’identité féminine marocaine. Une femme marocaine ne peut concevoir sa présence à un mariage sans caftan ou takchita.
Et j’ai poursuivi :
– En Algérie, le caftan n’a pas connu le même enracinement. Il est resté limité à certaines régions, souvent proches du Maroc, comme Tlemcen. Ce n’est pas le vêtement symbolique de la femme algérienne, contrairement au karakou ou à la gandoura kabyle. Ces tenues sont très belles et nous ne vous les contestons pas. Pourquoi alors revendiquer le caftan ?
Lotfi, un peu étonné, répondit :
– C’est vrai que les plus beaux caftans viennent du Maroc, on ne le nie pas. Mais alors pourquoi tant de bruit à propos du maillot d’entraînement de l’équipe algérienne conçu par Adidas ? Le zellige vous appartient aussi ? Et le patrimoine authentique , comme vous dites ?
Je le regardai dans les yeux :
– Lotfi, cite-moi un autre endroit que le palais El Mechouar où l’on trouve du zellige en Algérie.
Il répondit rapidement :
– Le zellige est partout en Algérie depuis l’époque ottomane.
Je lui demandai :
– Es-tu sûr qu’il s’agit bien du même zellige que celui de Tlemcen, avec ses formes géométriques colorées et régulières ?
Il baissa les yeux :
– À vrai dire, je ne me souviens que de celui du palais El Mechouar dans ce style.
Je lui montrai alors les murs du jardin :
– Regarde autour de toi, Lotfi. Ce zellige, ici à la mosquée, est le même que dans toutes les mosquées et riads du Maroc.
Il me demanda avec curiosité :
– Qui l’a construit, ce lieu ?
J’expliquai :
– La Grande Mosquée de Paris, inaugurée en 1926, a été bâtie avec la participation d’artisans marocains, sous la supervision des autorités françaises. L’architecte principal, Maurice Tranchant de Lunel, était alors directeur des Beaux-Arts au Maroc. Il a directement inspiré la mosquée du style marocain almohade, notamment les mosquées Al Quaraouiyine à Fès et Koutoubia à Marrakech.
Avec fierté, j’ajoutai :
– La majorité de nos mosquées au Maroc ont cette même décoration. Comment pouvez-vous alors revendiquer ce style architectural que nous avons sous les yeux depuis des siècles ?
Lotfi répondit :
– Très bien. Mais alors, pourquoi empêcher Adidas d’utiliser le zellige dans notre maillot ?
Je lui dis en souriant :
– Personne ne vous empêche de vous en inspirer. Mais il faut simplement respecter son origine, car c’est un élément d’identité millénaire.
Et j’ai poursuivi :
– Tu sais que le Maroc a enregistré le zellige de Fès comme marque de certification officielle au Canada, sous le numéro App. 2173171 ? Cela signifie que toute production sous cette appellation doit respecter des normes spécifiques liées à la région de Fès. C’est le ministère marocain de l’artisanat qui a fait cette démarche pour protéger ce patrimoine à l’international.
Lotfi me lança avec défi :
– Et le couscous, alors ? Il est marocain lui aussi ?
Je répondis en riant :
– Vous avez votre couscous, et nous avons le nôtre ! (nous rîmes ensemble). Le couscous est un patrimoine commun, enraciné autant chez vous que chez nous. Chaque région du Maroc a sa propre manière de le cuisiner. Et chez nous, il est toujours le plat du vendredi après la prière. C’est pourquoi nous l’avons enregistré comme patrimoine partagé maghrébin auprès de l’UNESCO.
J’ajoutai :
– Comme le couscous, de nombreux éléments de notre culture sont communs : le malouf chez vous ressemble à la musique andalouse « al-âla » chez nous, le gharnati est présent des deux côtés, la qachabia algérienne est la sœur de la djellaba marocaine, le burnous chez vous est l’équivalent de notre selham. Le raï est né à Oran mais il a évolué aussi bien en Algérie qu’au Maroc. C’est un patrimoine commun, une richesse pour tous.
Lotfi me lança :
– C’est bien beau tout ça, mais dans tout ce que tu as cité, soit c’est marocain, soit c’est partagé. Et nous ? Où est notre patrimoine propre ?
Je lui répondis en souriant :
– Bien sûr que votre pays est riche en patrimoine. C’est normal, vu sa taille. Mais le problème, c’est que vos médias et réseaux sociaux se concentrent soit sur le patrimoine marocain pour le revendiquer, soit sur le patrimoine commun pour se l’approprier, oubliant que vous avez aussi un patrimoine propre que vous devriez mettre en valeur. Il est tout à fait naturel d’aimer le patrimoine de ses voisins, même de s’en inspirer, mais il faut reconnaître les origines.
J’ajoutai :
– Tu vois les jolis motifs floraux sur le nouveau maillot de votre équipe ? Avons-nous protesté ? Non. Car c’est votre patrimoine. Vous avez hérité du style ottoman, avec ses arabesques, ses dômes, ses cours. Le style colonial français s’y est ajouté dans les grandes villes. Nous, au Maroc, avons conservé notre style andalou-mauresque : zellige, bois sculpté, patios, kasbahs berbères… Ces différences font la richesse de chacun, pas une raison de conflit.
Lotfi conclut alors, alors que l’appel à la prière du Maghreb résonnait dans la mosquée :
– Tu as raison, Ahmed. Nos conflits ont souvent des solutions… si la volonté et la sincérité sont là.
Il me regarda avec espoir :
– Mais dis-moi, comment retrouver la confiance ? Comment reconstruire ce lien entre nous ?
Je lui répondis en regardant le minaret, baigné de lumière au crépuscule :
– Lotfi, tant qu’il y a Dieu, il y a espoir. Allons prier d’abord… puis poursuivons cette conversation la semaine prochaine. Ce sera peut-être le premier fil avec lequel tisser à nouveau la confiance, dans cet océan d’accusations qui submerge nos deux peuples.