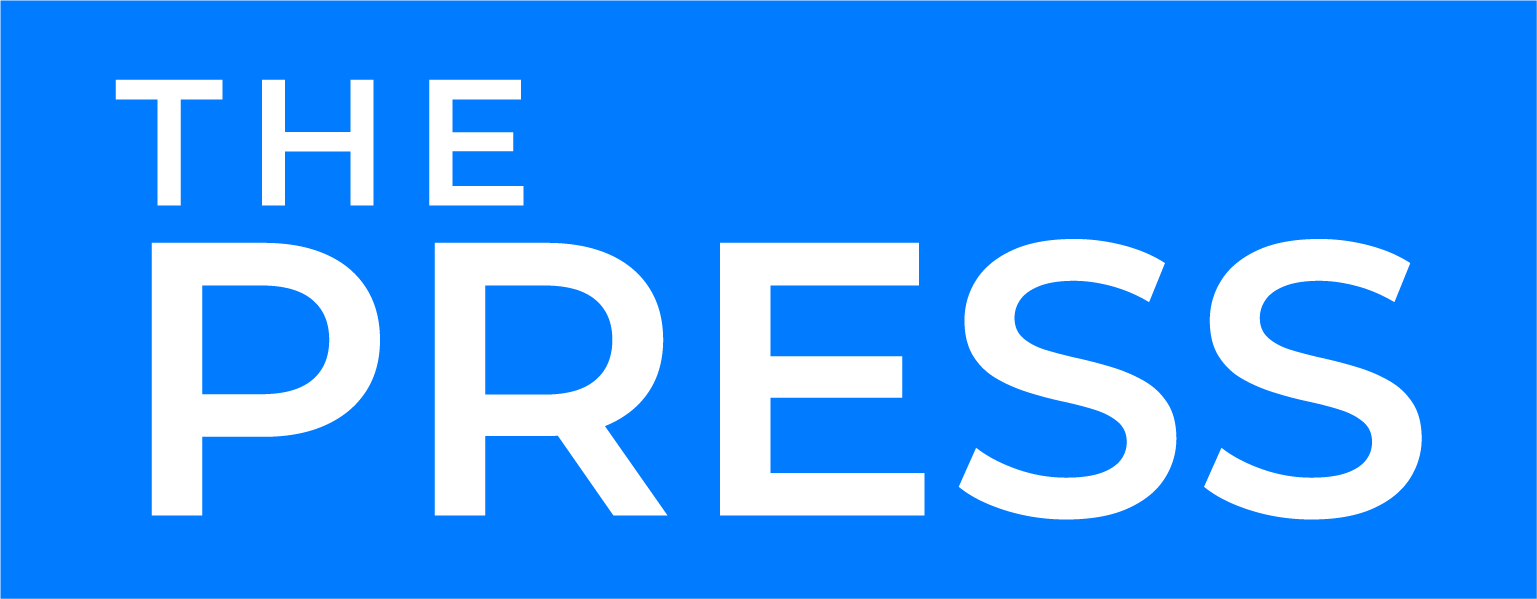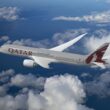En Ukraine, une décision législative a provoqué l’une des plus grandes vagues de contestation depuis le début de l’invasion russe. Le 22 juillet 2025, le Parlement ukrainien adoptait une loi controversée visant à placer les agences nationales de lutte contre la corruption, NABU et SAPO, sous l’autorité directe du procureur général — lui-même nommé par le président. Le président Volodymyr Zelensky, qui a signé dans la foulée cette mesure, justifiait cette centralisation par la nécessité de contrer l’infiltration russe dans les institutions. Mais pour une large partie de la population et des observateurs internationaux, cette réforme sonnait comme un net recul démocratique.
La réaction a été immédiate. Le lendemain du vote, des milliers de manifestants ont déferlé dans les rues de Kyiv, Lviv, Odessa ou encore Kharkiv, rassemblant société civile, anciens combattants et jeunes générations unies contre ce qu’elles percevaient comme un affaiblissement de l’État de droit. Plusieurs capitales européennes ont rapidement exprimé leur inquiétude, à commencer par Bruxelles, où les institutions européennes ont rappelé que l’indépendance des organes de lutte contre la corruption constitue un critère non négociable pour l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne. Le G7, tout comme des chancelleries occidentales, a alerté Kyiv sur le risque de perdre la confiance de ses alliés en pleine guerre.
Face à l’ampleur de la mobilisation et à la pression diplomatique croissante, Zelensky a fini par infléchir sa position. Dès le 23 juillet, il annonçait dans une adresse vidéo qu’un nouveau projet de loi serait déposé « dans les deux semaines » pour rétablir l’autonomie pleine et entière du NABU et de SAPO. Le lendemain, un texte rectificatif était déjà présenté à la Rada, le parlement ukrainien, salué par les directions des agences concernées comme un pas dans la bonne direction. Le président a tenté de rassurer ses partenaires en affirmant que Kyiv n’entendait pas revenir sur les fondements démocratiques des réformes enclenchées depuis Maïdan.
Cet épisode illustre la fragilité des équilibres institutionnels ukrainiens en temps de guerre, mais aussi la vitalité d’une société civile capable d’imposer un rétropédalage présidentiel. Il montre que, malgré l’état d’urgence sécuritaire, l’aspiration à la transparence reste un pilier fondamental du contrat entre l’État et les citoyens. Pour Zelensky, ce rappel à l’ordre est double : il souligne à la fois l’importance de la légitimité intérieure face à une population en guerre, et la nécessité de préserver une crédibilité internationale indispensable à l’effort diplomatique et militaire. L’épisode restera comme un test démocratique majeur pour une Ukraine en quête d’Europe.