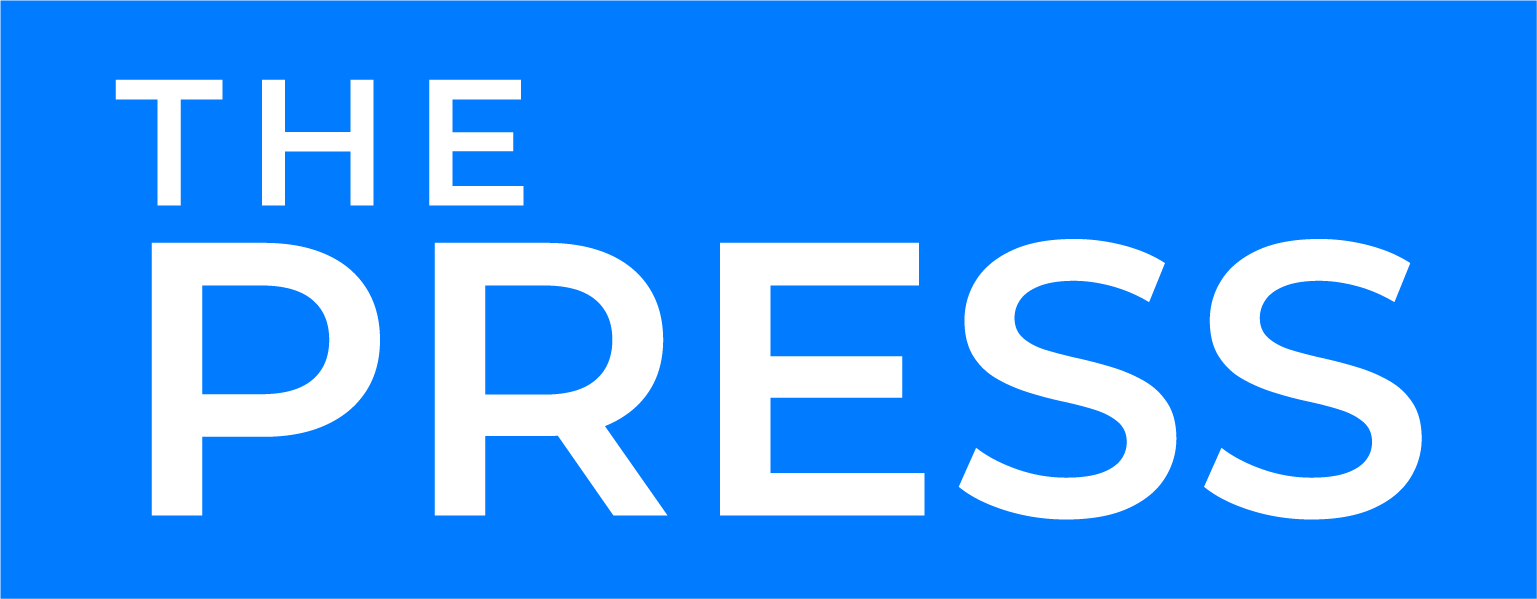Dans une déclaration officielle publiée le 31 juillet 2025, l’administration américaine a annoncé la révision unilatérale des droits de douane applicables à vingt pays africains, invoquant la nécessité de « restaurer l’équilibre commercial » et de mettre fin à ce qu’elle considère comme des pratiques tarifaires discriminatoires à l’égard des produits américains. Cette décision, signée par le président Donald Trump dans le cadre d’un décret exécutif, marque une nouvelle escalade dans la politique commerciale des États-Unis à l’égard du continent africain, sous la bannière toujours affichée de America First.
Les pays concernés par cette reconfiguration sont : le Nigeria, le Kenya, le Ghana, l’Éthiopie, l’Ouganda, le Lesotho, l’Eswatini, le Botswana, la Namibie, le Malawi, le Togo, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, la Zambie, le Rwanda, le Bénin, le Cameroun, le Mozambique, Madagascar et la Tanzanie. La plupart bénéficiaient jusqu’ici de facilités tarifaires dans le cadre de l’initiative AGOA (African Growth and Opportunity Act), censée promouvoir les exportations africaines vers le marché américain. Désormais, des droits allant jusqu’à 50 % seront imposés sur plusieurs produits-clés, notamment les textiles, les produits agricoles transformés, les conserves de fruits, le cuir et certains biens manufacturés.
Les répercussions ont été immédiates. Au Lesotho, premier pays à subir les effets de cette décision, de nombreux importateurs américains ont annulé leurs commandes, provoquant des fermetures d’usines et une vague de licenciements dans le secteur textile, principal moteur de l’économie nationale. En Éthiopie, la zone industrielle de Hawassa enregistre un repli brutal de ses activités. Au Ghana et au Bénin, les filières agroalimentaires – notamment les fruits en conserve et l’ananas transformé – s’effondrent sous le poids des surcoûts imposés par les nouveaux tarifs. Pour des économies aussi vulnérables, la dépendance à un seul débouché commercial devient un facteur de déstabilisation systémique.
Face à cette offensive douanière, les gouvernements africains oscillent entre consternation diplomatique et tentatives de négociation. Certains, comme le Kenya, la Côte d’Ivoire ou le Sénégal, ont engagé des discussions bilatérales en urgence, espérant obtenir des dérogations ciblées. D’autres misent sur une riposte coordonnée au sein de l’Union africaine ou via l’Organisation mondiale du commerce. Mais dans les faits, le rapport de force est brutalement asymétrique. L’initiative américaine expose aussi les limites de la stratégie africaine en matière d’intégration économique régionale, encore embryonnaire malgré les promesses de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).
Plus largement, cette décision du 31 juillet révèle une fracture croissante dans les relations Nord-Sud : celle entre les discours sur la coopération équitable et la réalité d’un monde régi par les rapports de puissance. En remettant en cause des acquis jugés irréversibles, Washington rappelle que le droit préférentiel reste avant tout un privilège révocable. Pour l’Afrique, l’enjeu n’est plus seulement d’exporter, mais de produire pour elle-même, de créer ses propres marchés et de réduire sa dépendance. Car dans un monde devenu brutalement imprévisible, les économies les plus fragiles sont aussi les plus exposées aux secousses de la géopolitique commerciale.