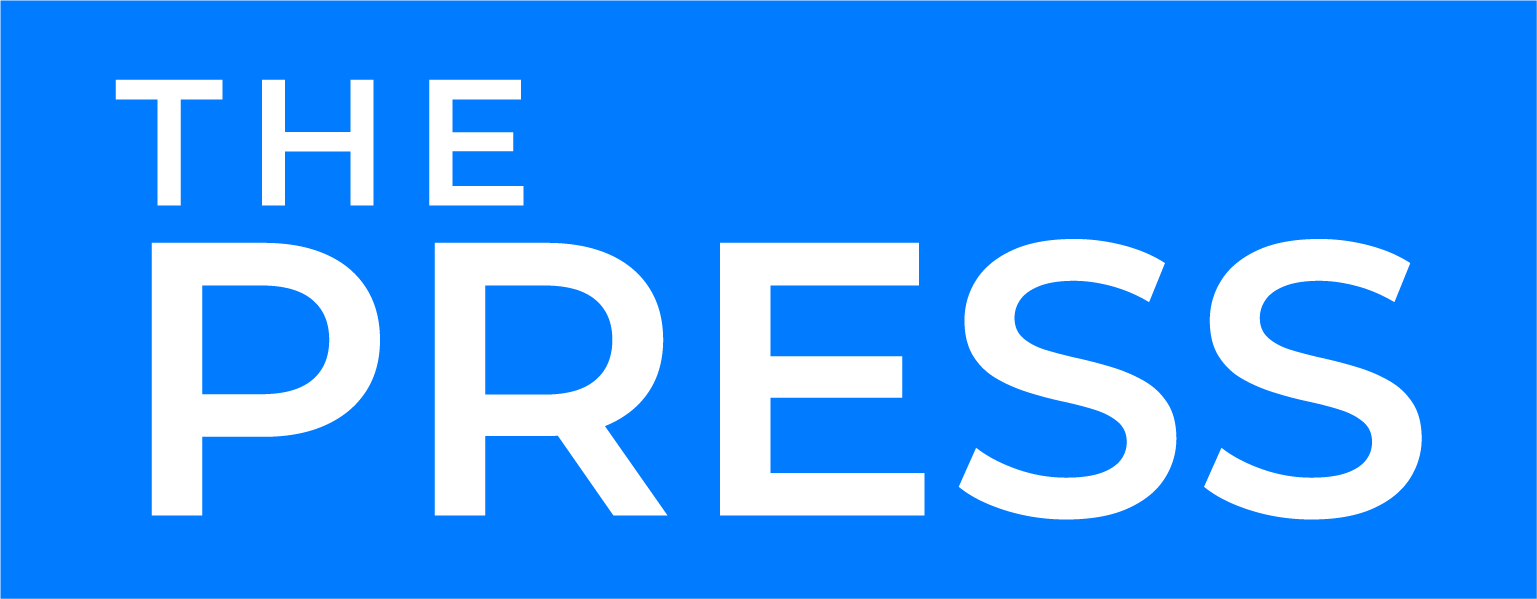Une enquête récente réalisée par le Centre marocain pour la citoyenneté en septembre a révélé un effondrement quasi total de la confiance des Marocains dans les partis politiques : 94,8 % des participants ont affirmé ne pas leur faire confiance, contre seulement 5,2 % qui disent leur accorder encore du crédit. L’étude, menée auprès de 1 197 personnes de tous âges et de toutes les régions via un questionnaire en ligne, montre également que 96,7 % des sondés estiment que le niveau de confiance a fortement chuté ces dernières années, alors que 2,6 % le jugent stable et 0,7 % notent une légère amélioration.
Selon les résultats, les partis politiques arrivent en tête des institutions frappées par une crise de confiance : 91,5 % des répondants jugent leur performance faible, suivis du Parlement (89,5 %), du gouvernement (87,3 %), des syndicats (84,7 %), de l’opposition politique (80,6 %) et des collectivités territoriales (78,2 %). Même les médias n’y échappent pas, 73 % des participants évaluant leur performance comme faible, tandis que les associations bénéficient d’une image un peu meilleure, avec 50,4 % d’avis négatifs.
Interrogé sur la portée de cette enquête, Rachid Essedik, président du Centre marocain pour la citoyenneté, a expliqué à THE PRESS qu’elle s’inscrit dans la stratégie du centre visant à faire de la voix des citoyens une composante essentielle du débat public, en recueillant leurs opinions sur les politiques qui les concernent directement. Il ajoute que le choix du thème des partis politiques est lié aux échéances législatives de 2026 et à la question de leur capacité à jouer leur rôle d’intermédiaire et de cadre d’action collective. L’objectif est de fournir des données qualitatives reflétant les perceptions et attentes des citoyens et de souligner le besoin de réformes profondes adaptées aux défis à venir.
Face aux résultats, Essedik souligne qu’ils ne sont pas tant surprenants qu’inquiétants, car ils traduisent un sentiment général qui s’est enraciné au fil des années. La perte de confiance est devenue une tendance lourde qui menace la légitimité de la médiation politique. Il estime que la responsabilité est partagée, mais que les partis portent la plus grande part du fardeau en raison du manque de démocratie interne, de la permanence des mêmes dirigeants, de l’absence de communication et de la réduction des élections à un événement ponctuel plutôt qu’à un processus continu.
L’enquête, intitulée « Les partis politiques marocains et la crise de crédibilité : résultats d’un sondage », montre que 91,2 % des participants ne sont actuellement membres d’aucun parti et que 71,6 % n’y ont jamais adhéré. Ceux qui s’en sont retirés citent le manque de démocratie interne (33,2 %), l’incapacité des partis à répondre aux aspirations (22,3 %), la marginalisation et l’exclusion (14,2 %) ainsi que les conflits internes (12,2 %). Par ailleurs, 76,2 % des non-membres affirment ne pas envisager d’adhérer à l’avenir. S’agissant de la démocratie interne, 97,9 % estiment qu’elle n’est pas respectée et 98,2 % affirment que les candidats ne sont pas choisis sur la base des compétences.
Essedik souligne que les partis se sont transformés en appareils fermés fonctionnant selon des logiques de loyautés et de clientélisme plutôt qu’à partir de programmes et de compétences. Le manque de transparence, les conflits d’intérêts et l’association de leur image à la corruption minent leur crédibilité, tandis que les jeunes et les femmes se retrouvent exclus ou utilisés comme vitrine, ce qui accentue l’abstention et fait des partis « une partie du problème plutôt qu’une partie de la solution ».
Selon l’enquête, 92 % des répondants estiment que l’intérêt matériel est la motivation principale des candidats aux élections, 91,5 % mentionnent la recherche du pouvoir et de l’influence, et 75,1 % la quête de l’immunité, alors que seuls 6,4 % associent la candidature au service de l’intérêt général. Pour ce qui est du vote des citoyens, l’argent arrive en tête (77,7 %), suivi par l’appartenance tribale ou régionale (55,4 %), les consignes familiales ou sociales (37,8 %). Viennent ensuite la proximité du candidat (26 %), son intégrité ou sa réputation (22 %), et seulement 8,6 % donnent la priorité au programme électoral.
Dans sa conclusion, Essedik affirme que cette enquête constitue un outil concret pour les acteurs politiques et les décideurs, car elle démontre par les chiffres que la crise de confiance a atteint des niveaux inédits. Elle révèle que l’abstention politique est fondamentalement une forme de protestation contre le fonctionnement des partis et pas seulement une absence aux urnes. Intégrer la voix citoyenne dans le débat public transforme l’opinion populaire en matière exploitable plutôt qu’en simple élément marginal.
Pour restaurer la confiance, 89,7 % des participants recommandent d’appliquer strictement le principe de reddition des comptes, 57,2 % de mettre fin à l’usage de l’argent dans les élections, 51,1 % de durcir les conditions de candidature et 48,1 % de respecter les programmes électoraux. Par ailleurs, 88,1 % demandent de limiter les mandats internes à deux, et 93,5 % jugent que le système électoral actuel n’aide pas à représenter la volonté populaire. Essedik conclut que, malgré la dureté des chiffres, ils constituent un appel clair aux partis pour qu’ils se réforment en profondeur et redonnent confiance aux citoyens, transformant cette étude en levier de changement et en préparation aux échéances de 2026.