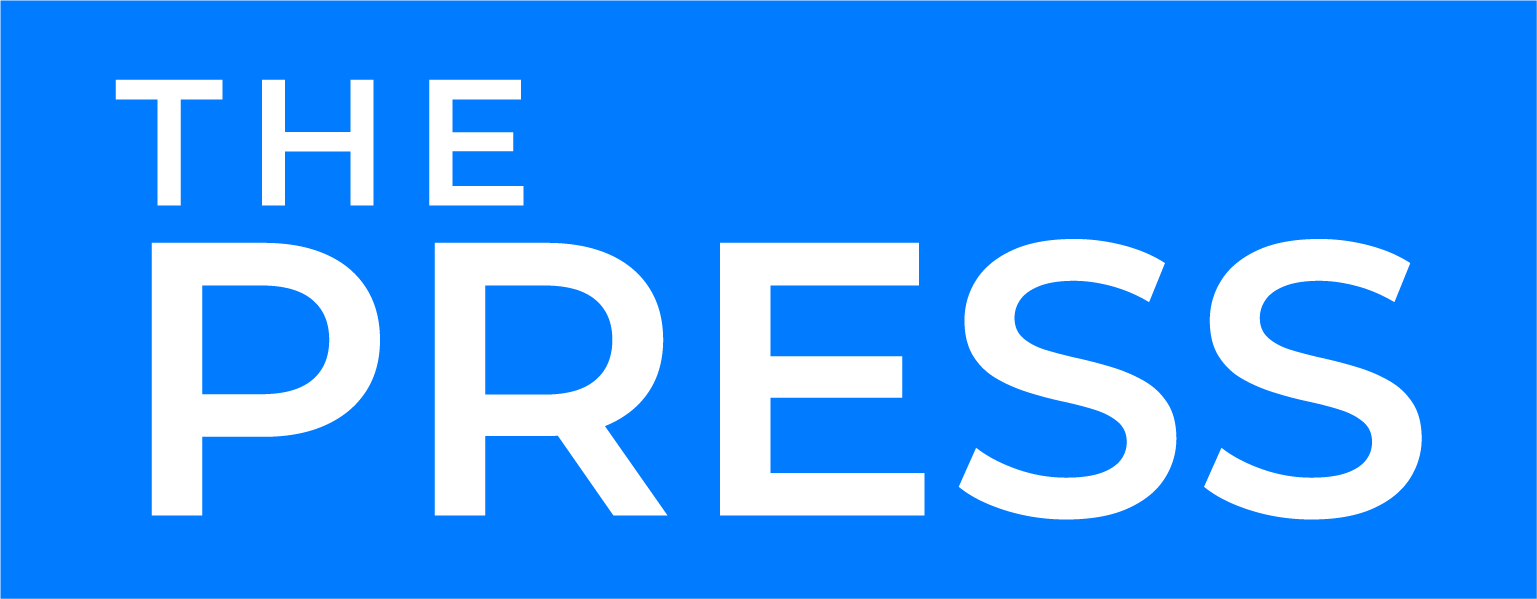En juin dernier, Kigali et Washington ont conclu un accord qui autorise le transfert de jusqu’à 250 migrants expulsés du territoire américain vers le Rwanda. Cette décision s’inscrit dans une nouvelle stratégie des États-Unis, qui cherchent à externaliser certaines procédures de déportation vers des pays tiers, en particulier en Afrique.
Pour le gouvernement rwandais, cette collaboration repose sur une logique humanitaire et sociétale. « Presque toutes les familles rwandaises ont connu les difficultés du déplacement, et notre société est fondée sur la réintégration et la réhabilitation », a souligné Yolande Makolo, porte-parole de l’exécutif. Une déclaration qui met en avant la mémoire collective du pays, façonnée par les traumatismes du génocide de 1994 et les déplacements massifs qu’il a entraînés.
Concrètement, les migrants acceptés bénéficieront d’un programme de réinsertion global. Celui-ci prévoit une formation professionnelle, une couverture sanitaire, ainsi qu’un soutien au logement, dans l’objectif de faciliter leur intégration durable dans la société rwandaise. Le projet entend ainsi allier sécurité migratoire pour les États-Unis et solidarité encadrée pour le Rwanda, pays souvent cité pour sa diplomatie agile et son positionnement international audacieux.
Cet accord n’est pas sans rappeler celui signé entre Kigali et Londres en 2022, bien que ce dernier ait été suspendu à la suite de contestations judiciaires au Royaume-Uni. Le partenariat avec Washington relance donc le débat sur le rôle croissant du Rwanda dans la gestion externalisée des flux migratoires mondiaux — entre enjeux géopolitiques, image de stabilité et pragmatisme économique