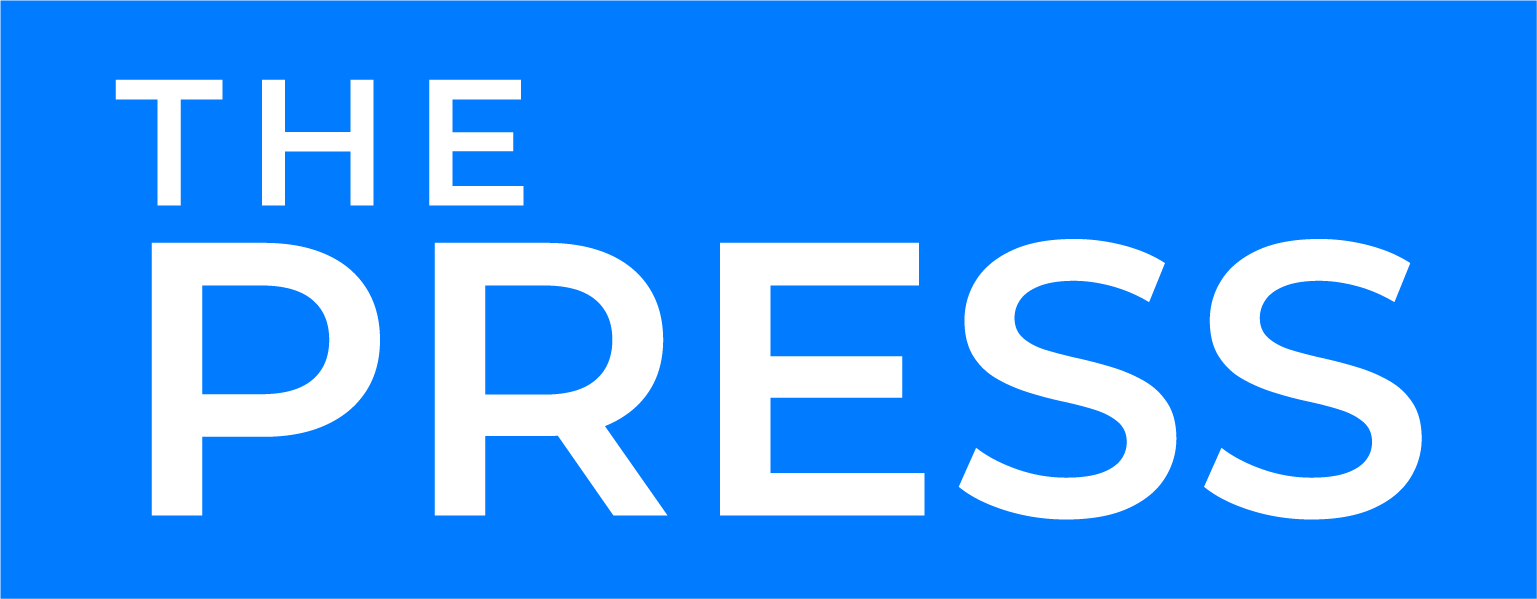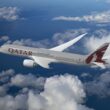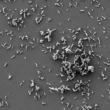Il est des signes qui ne trompent pas. Quand une équipe nationale s’applique à dissimuler un logo sur un badge ou à effacer un visuel sur une retransmission officielle, ce n’est plus du sport, c’est de la pathologie. La Confédération africaine de football vient d’adresser un avertissement à la Fédération algérienne pour ces pratiques absurdes. Ce n’est pas seulement puéril, c’est révélateur. Révélateur d’une marocophobie systémique, presque maladive, entretenue au plus haut niveau de l’État algérien. Une obsession qui ne dit plus seulement le rejet de l’autre, mais la dérive d’un pouvoir incapable de se projeter ailleurs que dans le déni du Maroc.
On pourrait encore s’indigner, regretter une énième fois les occasions manquées par cette guerre froide absurde entre deux peuples frères. Mais cela ne mène plus à rien. Il faut désormais se projeter, faire un pas de côté, observer le temps long. Et le constat est brutal : cette histoire va mal finir. Car dans trente ans, si rien ne change, le Maroc aura continué d’avancer, pendant que l’Algérie se sera enfermée dans sa propre impasse. Prenons les trois points de fracture : le Sahara, les frontières, et l’économie. Dans les trois cas, le futur est déjà écrit.
D’abord, le Sahara. La réalité géopolitique est claire : la souveraineté du Maroc est de plus en plus largement reconnue. D’ici à 2028, le dossier sera définitivement verrouillé. Les grandes puissances auront acté ce que le terrain impose déjà. Et la question, loin de se régler en faveur d’Alger, sera tout simplement rayée des agendas internationaux. L’Algérie aura dépensé des milliards, miné ses relations régionales, freiné son propre développement… pour rien. Un combat idéologique perdu d’avance, une illusion de grandeur dans une bataille qui n’avait pas lieu d’être.
Ensuite, les frontières. Peut-on sérieusement croire qu’un pays puisse vivre replié sur lui-même jusqu’en 2055 ? Le monde change à une vitesse vertigineuse. L’intelligence artificielle, la transition énergétique, la recomposition des échanges mondiaux… autant de révolutions auxquelles l’Algérie ne pourra participer sans intégration régionale. Et quoi qu’en pensent les hommes actuellement au pouvoir, ils passeront la main – non pas par choix ou lucidité politique, mais tout simplement parce que la vie est ainsi faite. On ne gouverne pas éternellement : on meurt. Et leurs successeurs, moins figés dans des fantasmes de guerre froide, n’auront d’autre choix que de rouvrir les portes. L’isolement est une stratégie suicidaire dans un monde où l’interdépendance n’est plus un choix, mais une condition de survie.
Enfin, l’économie. Depuis l’arrivée d’Abdelmadjid Tebboune, l’Algérie s’enfonce dans un modèle étatique rigide, peuplé de discours hostiles, de lois de blocage et de fermeture tous azimuts. Pendant ce temps, le Maroc avance. Il attire les investissements, renforce son industrie, modernise ses infrastructures, s’ouvre à l’Afrique. Le contraste est saisissant. Deux pays voisins, deux choix diamétralement opposés. Et au bout du chemin, une divergence irréversible : l’un prépare l’avenir, l’autre s’y refuse.
Alors la vraie question, la seule qui vaille, est la suivante : jusqu’à quand le pouvoir algérien va-t-il sacrifier l’avenir de son peuple pour une hostilité stérile ? Jusqu’à quand les hydrocarbures serviront-ils de masque à l’échec ? Car le développement n’est pas une opinion. C’est un projet, un élan, un pari sur l’intelligence collective. Dans trente ans, il sera trop tard pour regretter. Le Maroc, lui, n’a pas attendu. Et même avec une pierre dans la chaussure, il continue d’avancer. L’Algérie, en misant tout sur le sabotage de son voisin, ne creuse pas un tunnel vers l’avenir : elle creuse sa propre tombe.
Ce qui se joue ici, ce n’est pas une querelle frontalière. C’est le gâchis d’un pays qui aurait pu être une puissance, et qui risque de finir en parenthèse. Pour un rêve absurde de division d’un royaume millénaire. Un hara-kiri historique dont les générations futures paieront le prix fort.