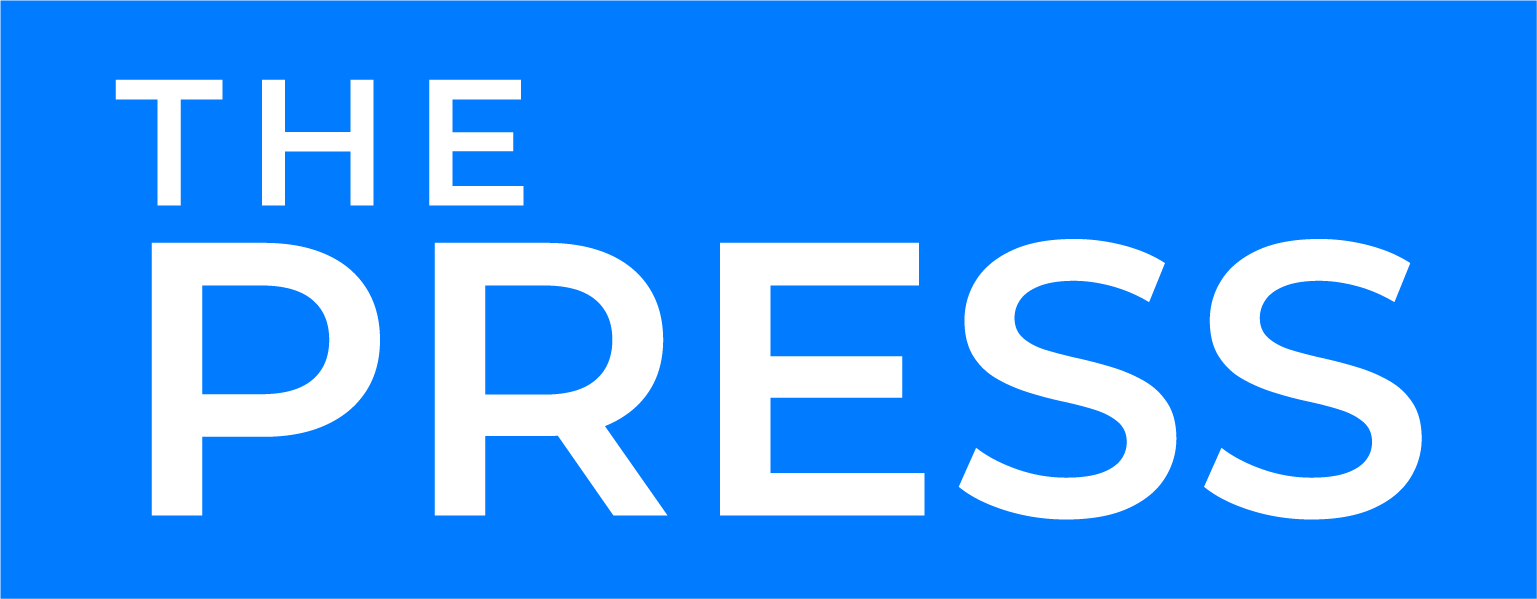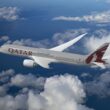Les prix mondiaux du pétrole ont chuté à leur plus bas niveau depuis plus de deux ans. Le Brent est passé sous la barre des 60 dollars le baril, atteignant 59,43 dollars, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) s’est établi à 56,36 dollars. Cette baisse soudaine résulte de la décision de l’OPEP+ d’augmenter la production à partir de juin, ce qui a accru l’offre sur un marché déjà marqué par un ralentissement de la demande mondiale.
Pour l’Algérie, dont l’économie repose presque entièrement sur les exportations d’hydrocarbures, cette chute représente une menace économique majeure. Les revenus pétroliers représentent environ 95 % des exportations du pays et plus de 60 % de son budget. Une telle baisse des prix risque d’entraîner une aggravation significative du déficit budgétaire, à un moment où les réformes économiques n’ont pas encore réussi à créer des sources alternatives de revenus.
Les réserves de change, estimées à environ 72 milliards de dollars fin 2024, pourraient s’éroder rapidement si la tendance baissière se poursuit, plaçant le pays devant un dilemme : opter pour une austérité budgétaire sévère ou se tourner vers des emprunts extérieurs, souvent assortis de conditions contraignantes. L’histoire récente rappelle la crise du milieu des années 1980, lorsque la chute des prix du pétrole avait déclenché une vague de troubles sociaux et politiques en Algérie.
Face à ces défis, l’Algérie se trouve à un tournant décisif : soit elle accélère sérieusement la diversification de son économie et investit dans des secteurs non pétroliers, soit elle risque de retomber dans la dépendance à des revenus volatils, avec des conséquences potentiellement graves sur sa stabilité financière et sociale.