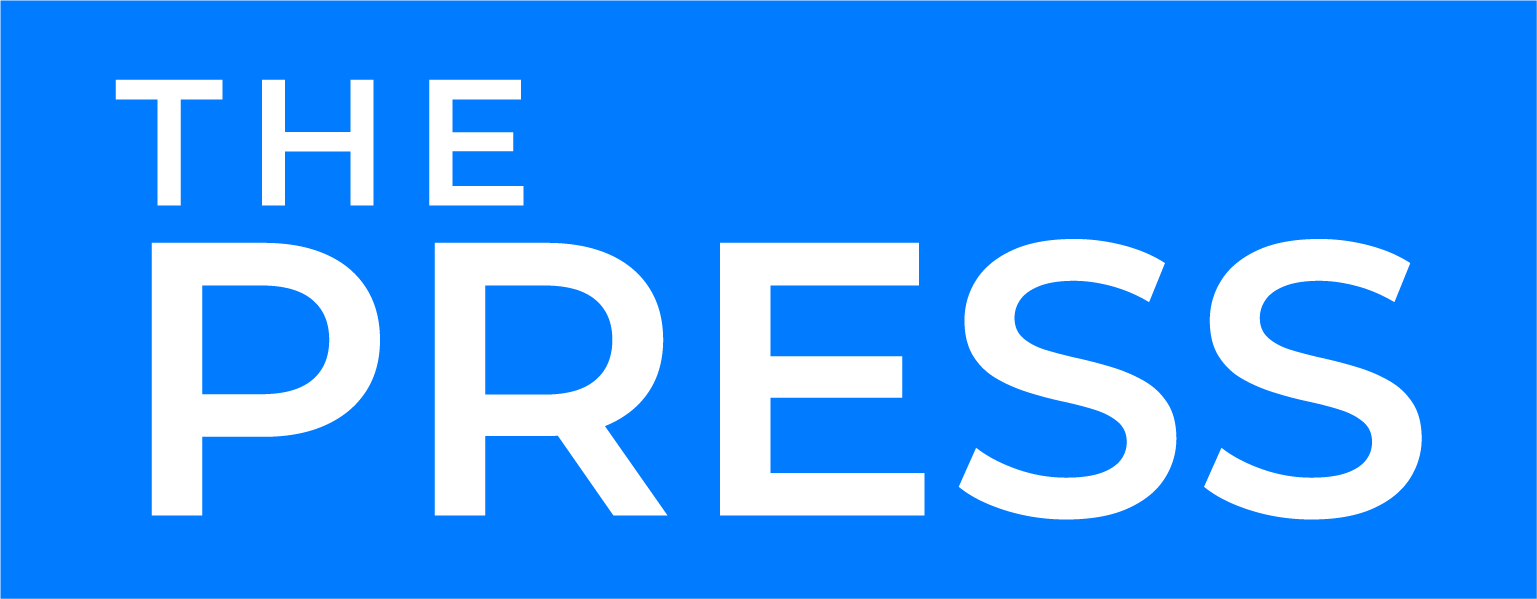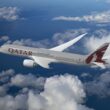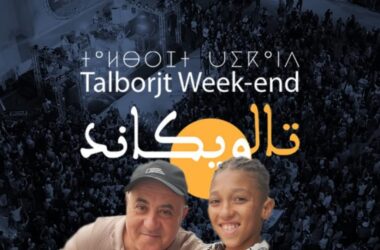Dans certaines villes françaises, un mot résonne avec une violence sourde : « Hara ! » — cri bref, lancé par un adolescent à la voix encore incertaine, pour prévenir de l’arrivée imminente de la police. Ce mot, simple et rugueux, s’est imposé comme le signal sonore d’une économie souterraine désormais banalisée, où des enfants deviennent les sentinelles d’un trafic qu’ils ne comprennent pas toujours. À Marseille, Nîmes, Montpellier ou dans les banlieues parisiennes, cette scène se répète chaque jour, dans l’indifférence d’un pays qui semble s’être résigné. Pour nous, Africains, voir les fils d’exilés — ces enfants qui auraient pu être les nôtres — s’égarer dans cette mécanique du guet et de la fuite, est une déchirure intime. Une trahison, peut-être, de ce rêve d’élévation que leurs parents avaient placé en France.
Il ne s’agit pas ici de caricaturer toute l’immigration. Ce serait non seulement injuste, mais aussi inexact. Des centaines de milliers de femmes et d’hommes, venus d’Afrique ou d’ailleurs, construisent chaque jour, dans l’ombre ou sous les projecteurs, une France plus diverse, plus riche, plus vivante. Mais réduire la question à cette seule réussite serait tout aussi fallacieux. Car ce que révèle le phénomène des “guetteurs” adolescents, dans ces cités reléguées, ce n’est pas tant une origine qu’un abandon. L’échec n’est pas culturel : il est institutionnel. Il n’est pas ethnique : il est social. Ce qui a échoué en France, c’est une certaine idée de la République, incapable de tenir sa promesse d’égalité une fois franchie la frontière des quartiers périphériques.
Le problème français, en vérité, n’est pas un problème de race. Il est, profondément, un problème de classe. La République ne rejette pas d’abord les Noirs, les Arabes ou les Gitans : elle rejette les pauvres. Elle les tolère à condition qu’ils soient discrets, conformes, invisibles. Mais dès qu’ils s’expriment avec leurs propres mots, leurs propres corps, leurs propres gestes — souvent incompris des élites —, ils deviennent une gêne, une menace, un échec à dissimuler. Car la pauvreté dérange. Elle n’a pas les codes, elle ne parle pas le langage des puissants, elle n’entre pas dans les salons. Elle rappelle au cœur même des sociétés développées que le progrès ne concerne pas tout le monde, et qu’il laisse des marges, des zones d’ombre, des enfants sans boussole. Et lorsque cette pauvreté est noire ou arabe, elle dérange deux fois : parce qu’elle est visible, et parce qu’elle est censée venir d’ailleurs.
Alors, quand retentit ce cri — « Hara ! » — ce n’est pas seulement l’alerte d’un adolescent à la solde d’un réseau. C’est le cri d’un monde que l’on a laissé tomber. Le cri d’un territoire orphelin d’institutions, de perspectives, d’attention. Le cri d’un échec qui n’est pas celui des familles seules, mais celui d’un système tout entier. Ce que la France affronte dans ses quartiers, ce ne sont pas des enfants d’immigrés incontrôlables. Ce sont ses propres fractures sociales, son propre aveuglement, ses propres lâchetés. Et pour nous, Africains, la douleur est double : car dans ces jeunes, c’est aussi une part de nous-mêmes que l’on voit se perdre. Le rêve que nous avions placé en l’Europe, en l’éducation, en la dignité offerte par l’exil, vacille quand nos enfants crient non pas pour être entendus, mais pour prévenir qu’il faut fuir.
La question, dès lors, n’est pas de savoir s’il faut plus de police ou plus de répression. Elle est de savoir quand la France décidera enfin de faire de ses banlieues une priorité nationale. Car l’avenir d’un pays ne se mesure pas à la solidité de ses murs, mais à la façon dont il traite ceux qui sont restés au seuil. Et cette vérité-là, universelle, vaudrait autant à Paris qu’à Lagos, Bangkok ou Johannesburg.