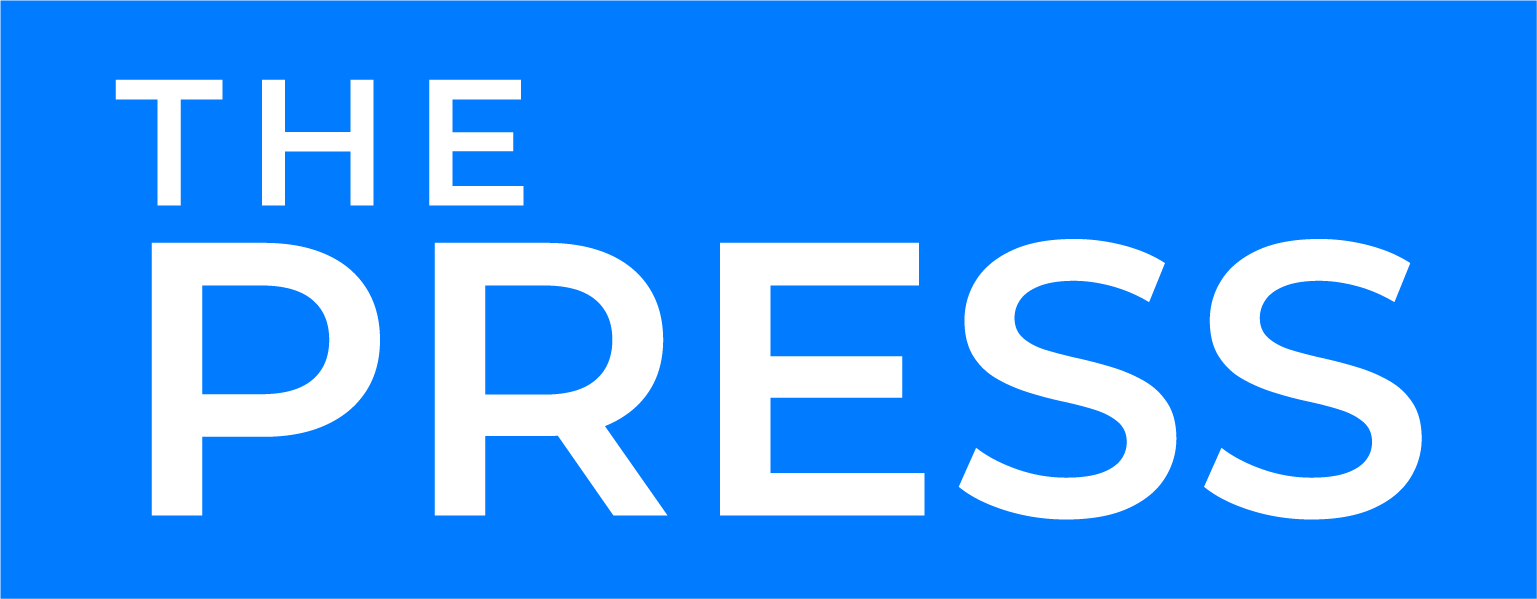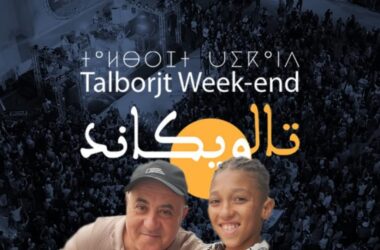Le ministère de l’Intérieur a lancé une nouvelle série de consultations avec les partis politiques en vue de préparer un projet de réforme du cadre général encadrant les élections législatives de 2026. Ces rencontres, menées à huis clos, donnent l’impression que la question électorale n’est qu’un simple dossier technique entre l’administration et les partis, alors même que le citoyen, premier concerné par l’acte électoral, en est largement absent.
L’absence de débat public autour des propositions soumises suscite de nombreuses interrogations. Ces propositions ne devraient pas rester confinées aux tiroirs du ministère ni aux procès-verbaux des réunions, mais nourrir un large débat national. Des questions telles que la représentation des femmes et des jeunes, les conditions d’éligibilité, l’exclusion des personnes soupçonnées de corruption, l’inscription des électeurs ou encore la participation des Marocains de l’étranger ne sont pas de simples détails procéduraux : ce sont des enjeux sociétaux majeurs liés à l’avenir de la démocratie et de la justice représentative.
La participation politique ne se limite pas au vote le jour du scrutin : c’est un processus global qui commence dès les discussions sur les lois électorales, se prolonge dans le suivi des candidatures et s’étend jusqu’au contrôle de la transparence du processus. Associer le citoyen à toutes ces étapes, c’est renforcer la confiance dans les institutions et éviter que les élections ne soient perçues comme un rituel formel, sans incidence réelle sur la représentation politique. Ouvrir le débat public apparaît dès lors comme une responsabilité partagée entre l’État et les partis politiques.
Cependant, la responsabilité la plus lourde incombe aux partis eux-mêmes, censés être des espaces de formation et de dialogue public. S’ils aspirent à gouverner, il leur revient de présenter leurs propositions aux citoyens, d’organiser des débats et des rencontres pour clarifier leurs positions, et de s’ouvrir aux contributions de la société civile, des chercheurs et des acteurs intéressés. La démocratie ne peut se réduire à des réunions à huis clos : elle se nourrit avant tout d’un dialogue ouvert et transparent.
Le véritable défi, aujourd’hui, ne réside donc pas uniquement dans la révision des textes électoraux, mais dans la réhabilitation du citoyen comme acteur essentiel dans l’élaboration des règles qui façonneront l’avenir de la vie politique. Sans transparence et sans débat public large, il sera impossible de regagner la confiance des électeurs ni d’assurer une participation effective aux prochaines échéances. Associer la société à cette réflexion est le levier central pour raviver l’esprit démocratique ; persister dans la logique actuelle ne conduira qu’à un approfondissement de l’abstention et de l’indifférence.