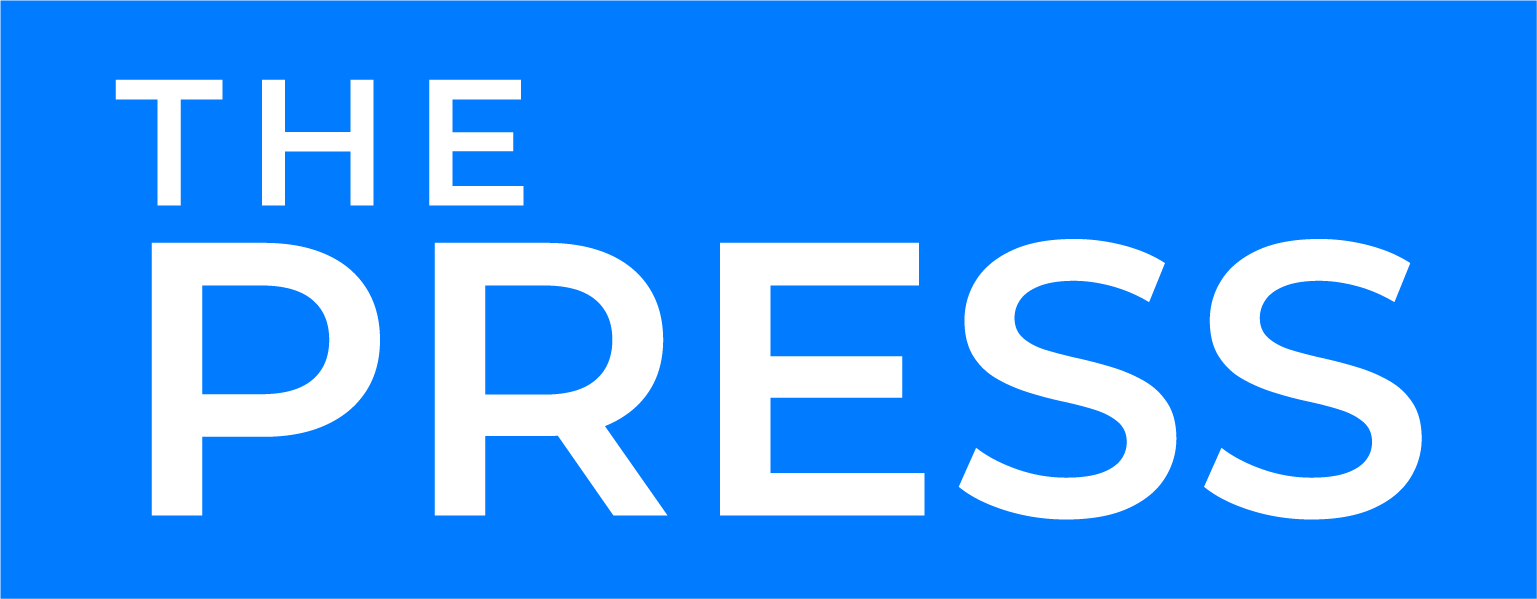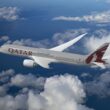Dans les années 1950, la cigarette s’affiche sans complexe : symbole de virilité, d’élégance ou d’émancipation selon les cibles marketing, elle envahit les écrans, les publicités et les stades. Pourtant, dès 1952, des études aux États-Unis commencent à établir un lien entre tabac et cancer du poumon. Mais l’industrie, puissante et stratégiquement organisée, mène une contre-offensive fondée sur le doute scientifique et le lobbying. Il faudra attendre les années 1970-1980 pour que les campagnes de prévention prennent de l’ampleur, notamment grâce à des politiques publiques plus affirmées, à la montée des actions citoyennes et à la publication de rapports alarmants, comme celui du Surgeon General américain ou du Comité scientifique de l’OMS.
La consommation de tabac connaît alors un tournant : en Europe et en Amérique du Nord, elle commence à décliner dès les années 1980, sous l’effet conjugué de la hausse des taxes, de l’interdiction de fumer dans les lieux publics, de la disparition de la publicité et de l’émergence des campagnes chocs. Les paquets neutres, les avertissements sanitaires illustrés, et plus récemment, les substituts nicotiniques et la cigarette électronique, ont poursuivi cette dynamique. En France, par exemple, la proportion de fumeurs quotidiens est passée de près de 45 % dans les années 1970 à environ 25 % aujourd’hui. Mais cette victoire reste partielle : l’addiction persiste dans certains milieux sociaux, et l’industrie, bien que affaiblie dans les pays occidentaux, s’est redéployée ailleurs.
Car si le tabagisme recule au Nord, il avance au Sud. L’Afrique, longtemps épargnée, devient aujourd’hui le nouveau front de la bataille anti-tabac. Selon l’Organisation mondiale de la santé, le continent pourrait connaître, d’ici 2030, une augmentation de plus de 70 % du nombre de fumeurs, la plus forte progression mondiale. Face à une jeunesse nombreuse, une urbanisation rapide et des réglementations parfois laxistes, les multinationales du tabac y voient un marché d’avenir. Les campagnes de prévention y sont encore embryonnaires, les taxes faibles, et les politiques de santé publique souvent sous-financées. Le marketing y est agressif, parfois ciblé vers les plus jeunes, dans des pays où les priorités sanitaires restent dominées par les maladies infectieuses.
Dans ce contexte, l’Afrique joue une partie décisive. L’enjeu n’est pas seulement sanitaire, mais aussi politique, économique et culturel. Certaines initiatives existent : interdictions de fumer dans les lieux publics au Sénégal, étiquetage renforcé en Afrique du Sud, taxation plus forte au Kenya. Mais l’absence de coordination régionale, la pression des lobbies et le manque de sensibilisation freinent les progrès. Pourtant, c’est ici que se décidera en grande partie l’avenir mondial de la lutte contre le tabac. Car pour l’industrie, l’Afrique est le dernier territoire à conquérir ; pour la santé publique, elle est le dernier bastion à défendre.