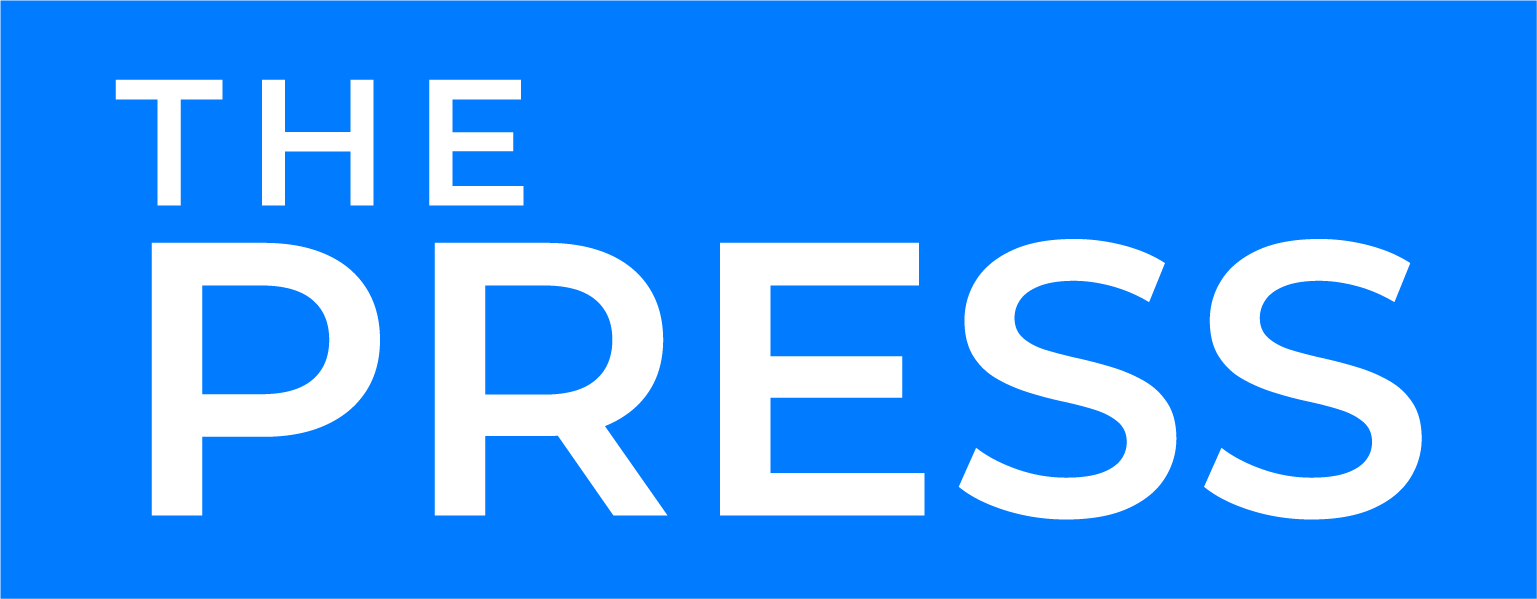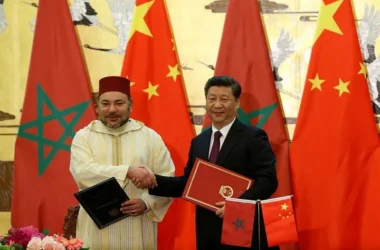Marguerite Gnakadè, ancienne ministre togolaise de la Défense et belle-sœur du président Faure Gnassingbé, a été arrêtée mercredi à son domicile, selon des médias locaux citant des sources de sécurité. Veuve d’Ernest Gnassingbé, frère défunt du chef de l’État, elle avait dirigé le ministère de la Défense de 2020 à 2022. Ces derniers mois, elle s’était distinguée par des critiques publiques appelant Faure Gnassingbé à quitter le pouvoir et à mettre un terme à ce qu’elle qualifiait de régime familial autoritaire.
Son arrestation intervient dans un contexte de crispations politiques croissantes. En mai dernier, Faure Gnassingbé a pris ses nouvelles fonctions de président du Conseil des ministres, à la faveur d’une réforme constitutionnelle qui lui permet de gouverner sans limitation de durée. Ce changement a consolidé son emprise sur l’exécutif et accentué les inquiétudes d’une partie de la société civile sur la dérive autoritaire du régime.
La révision de la constitution et la perspective d’un pouvoir illimité ont provoqué une vague de manifestations à travers le pays. Mais ces rassemblements ont été durement réprimés par les forces de sécurité, confirmant une fois de plus la difficulté des Togolais à contester un système verrouillé depuis plus d’un demi-siècle par la même famille. Sur les réseaux sociaux, quelques opposants ont osé dénoncer l’arrestation de Mme Gnakadè, y voyant un signal inquiétant envoyé à toute voix dissidente, y compris au sein du cercle présidentiel.
L’affaire met en lumière une réalité souvent occultée des régimes africains : les luttes intestines au sein même des familles et des élites au pouvoir. Lorsque la contestation surgit de l’intérieur, elle est parfois perçue comme plus menaçante que celle portée par l’opposition classique. La parole critique d’une ancienne ministre, membre du premier cercle familial, souligne les fractures qui traversent les régimes autoritaires, où les alliances personnelles se heurtent aux ambitions politiques.
Le cas togolais illustre ainsi une dynamique plus large sur le continent, où plusieurs dirigeants s’efforcent de modifier les constitutions pour se maintenir indéfiniment au pouvoir. Mais cette concentration du pouvoir nourrit inévitablement des rivalités internes, souvent étouffées dans la répression. Ces tensions posent une question cruciale : jusqu’où les régimes africains peuvent-ils survivre aux divisions qui naissent en leur sein, et quelles conséquences ces fractures auront-elles pour la stabilité des États ?