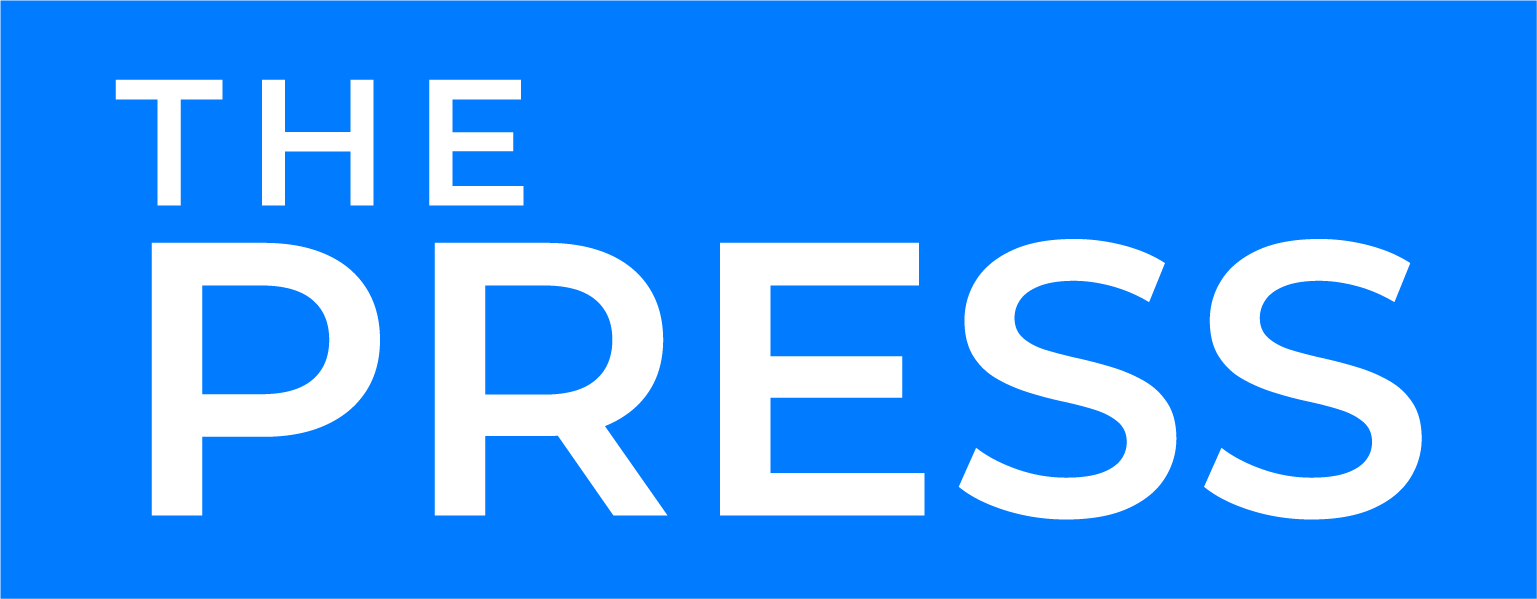Dans un arrêt retentissant rendu ce 1er août, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a porté un coup sévère à l’architecture juridique qui régissait jusqu’ici le monde du sport professionnel. Elle affirme que les tribunaux des États membres doivent pouvoir exercer un contrôle juridictionnel complet sur les décisions du Tribunal arbitral du sport (TAS), malgré son implantation en Suisse. En d’autres termes, les sentences du TAS ne peuvent plus faire écran à la justice européenne, au nom d’une prétendue autonomie du sport. C’est un tournant historique, qui ébranle l’un des piliers de la gouvernance mondiale du football.
La Cour de Luxembourg fonde sa décision sur deux principes cardinaux du droit européen : le droit à un procès équitable et l’accès effectif à un juge. Elle juge incompatible avec ces garanties le fait qu’un acteur du sport européen – club, joueur ou agent – se voie privé de tout recours véritable, au motif que l’instance arbitrale compétente siège hors de l’Union. La non-appartenance de la Suisse à l’UE n’exonère en rien le système sportif international de respecter les droits fondamentaux européens lorsqu’il touche directement des ressortissants de l’Union.
À l’origine de ce séisme juridique : un bras de fer engagé en 2015 par le RFC Seraing, modeste club belge, et le fonds d’investissement maltais Doyen Sports. Tous deux contestaient l’interdiction faite par la FIFA de la “Third-Party Ownership” (TPO), c’est-à-dire la propriété par des tiers des droits économiques des joueurs. Sanctionnés, ils avaient porté l’affaire devant le TAS – sans succès – avant de saisir la justice belge, laquelle avait transmis le litige à la CJUE. Celle-ci ne statue pas ici sur la légalité du TPO, mais sur le verrouillage juridique mis en place pour empêcher tout véritable débat contradictoire.
Depuis sa création en 1984 à Lausanne, le TAS s’est imposé comme l’arbitre quasi-exclusif des conflits sportifs internationaux. Il traite chaque année près d’un millier d’affaires, dont une majorité dans le football, et bénéficie d’un soutien financier substantiel des grandes fédérations, notamment la FIFA, qui lui a versé 2,5 millions de francs suisses en 2023. Ce modèle, qui mêle proximité financière et juridiction spécialisée, est aujourd’hui sévèrement remis en question. Il apparaît de plus en plus incompatible avec les standards démocratiques de justice.
Ce n’est pas la première fois que la CJUE s’invite dans les coulisses du sport mondial. Après avoir fragilisé le monopole de l’UEFA dans l’affaire de la Super League, ou rappelé les droits des joueurs dans le dossier Lassana Diarra, elle confirme sa volonté d’imposer l’État de droit là où le sport s’était trop longtemps cru à l’abri. L’arrêt du 1er août ne signe pas la fin du TAS, mais il en redéfinit profondément les contours : à l’avenir, l’autonomie du sport ne pourra plus servir de refuge à une justice parallèle. L’Europe a fait son entrée sur le terrain.