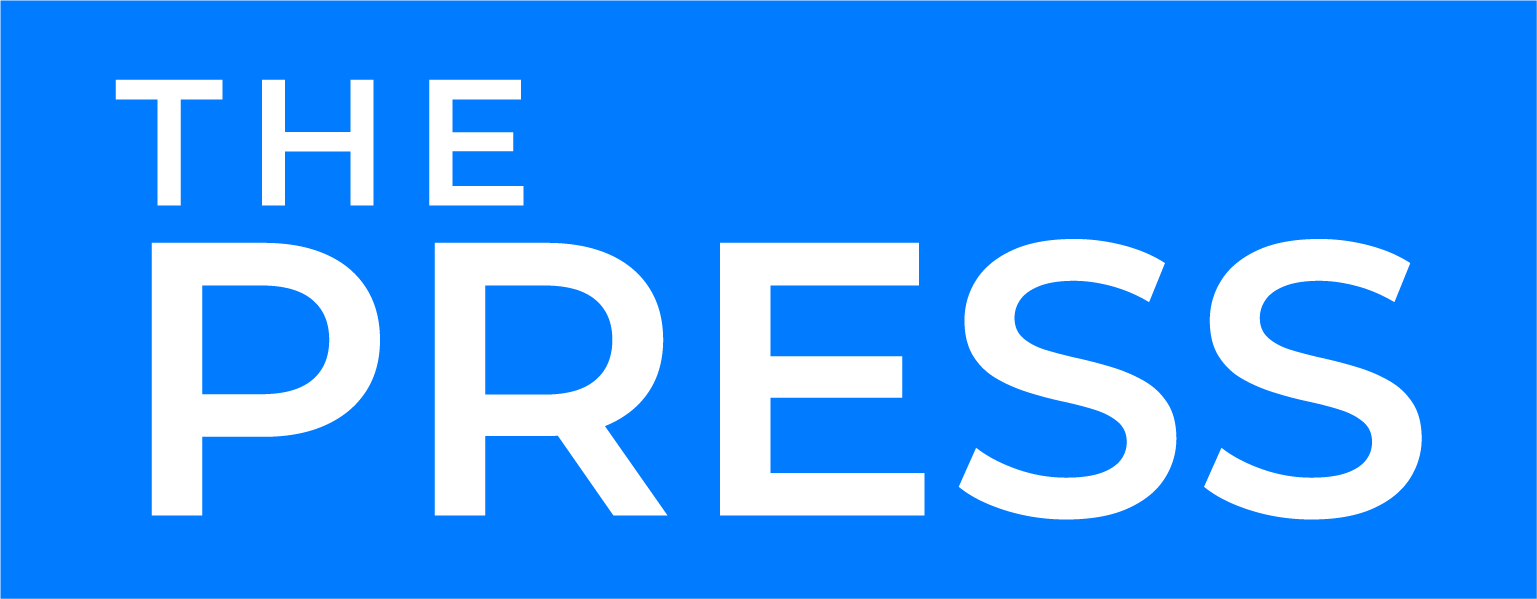Après cinq jours d’affrontements d’une intensité inédite depuis plus d’une décennie, la Thaïlande et le Cambodge ont conclu ce dimanche 28 juillet un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, sous l’égide de la Malaisie. C’est à Putrajaya, capitale administrative malaisienne, que le Premier ministre Anwar Ibrahim, président en exercice de l’ASEAN, a orchestré cette désescalade diplomatique en présence des dirigeants cambodgien et thaïlandais. L’accord, arraché in extremis, vise à enrayer une spirale de violences qui a déjà causé la mort de plus de 35 personnes, majoritairement civiles, et le déplacement de quelque 300 000 habitants des zones frontalières.
Le conflit, déclenché le 24 juillet par l’explosion d’une mine dans une zone contestée, a rapidement dégénéré en échanges d’artillerie, frappes aériennes ciblées et tirs de roquettes. L’épicentre de la crise demeure la région frontalière du temple de Preah Vihear, objet de rivalités anciennes et de ressentiments non résolus depuis les arrêts de la Cour internationale de justice. Sur le terrain, les scènes de détresse se sont multipliées, entre familles fuyant sous les bombes, temples bouddhistes convertis en abris de fortune et volontaires improvisant des chaînes de solidarité dans le chaos.
Au-delà de son cadre bilatéral, cet accord consacre l’irruption des puissances globales dans un conflit régional. Les États-Unis, représentés par le président Trump, ont exercé une pression décisive, conditionnant toute avancée diplomatique à un arrêt immédiat des hostilités. De son côté, la Chine, alliée indéfectible du Cambodge, s’est positionnée en observateur actif. Cette dualité révèle à quel point les lignes de fracture en Asie du Sud-Est sont désormais traversées par des intérêts concurrents, rendant chaque crise locale potentiellement explosive à l’échelle géopolitique.
Mais si la trêve permet de contenir l’hémorragie humaine, elle ne résout rien des causes profondes du conflit. La défiance réciproque, l’instrumentalisation du nationalisme à des fins politiques internes, et l’absence de mécanismes durables de règlement des différends minent tout espoir de stabilité. La paix ne saurait être décrétée : elle se construit, patiemment, à travers un dialogue sincère, un respect mutuel et une volonté partagée de sortir d’une logique de confrontation. À défaut, ce cessez-le-feu ne sera qu’une pause entre deux tempêtes.