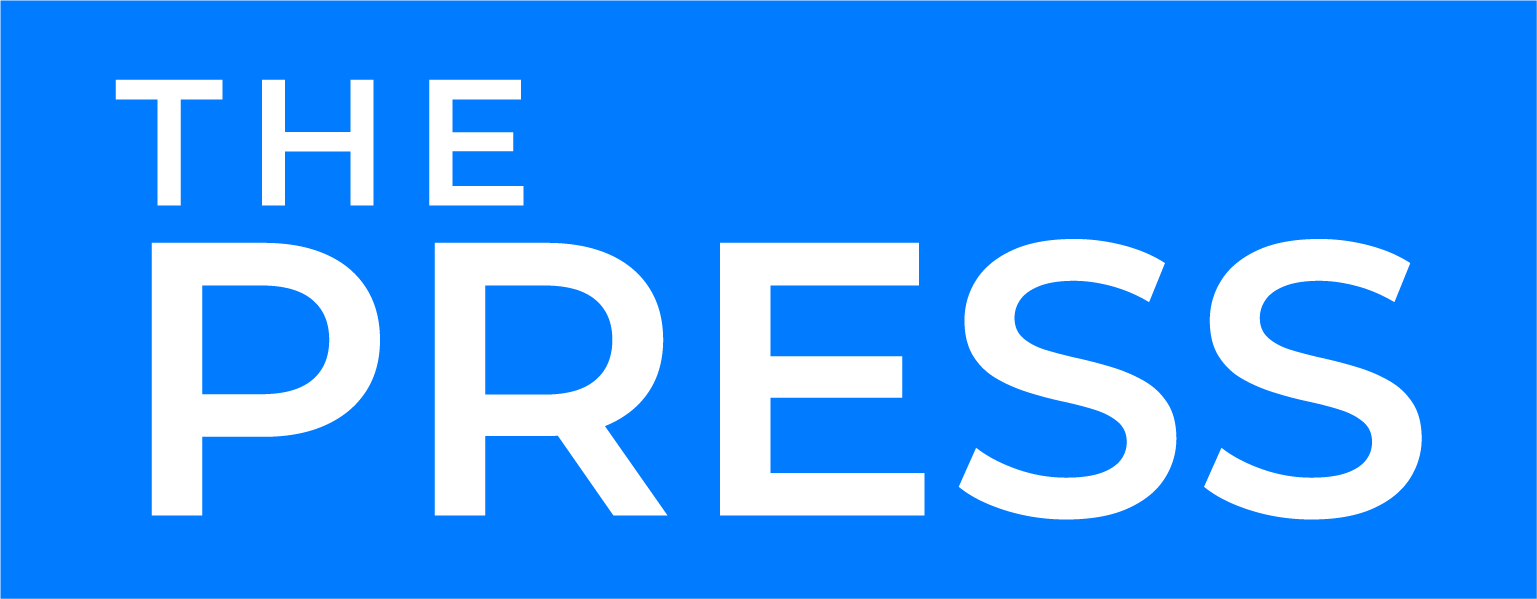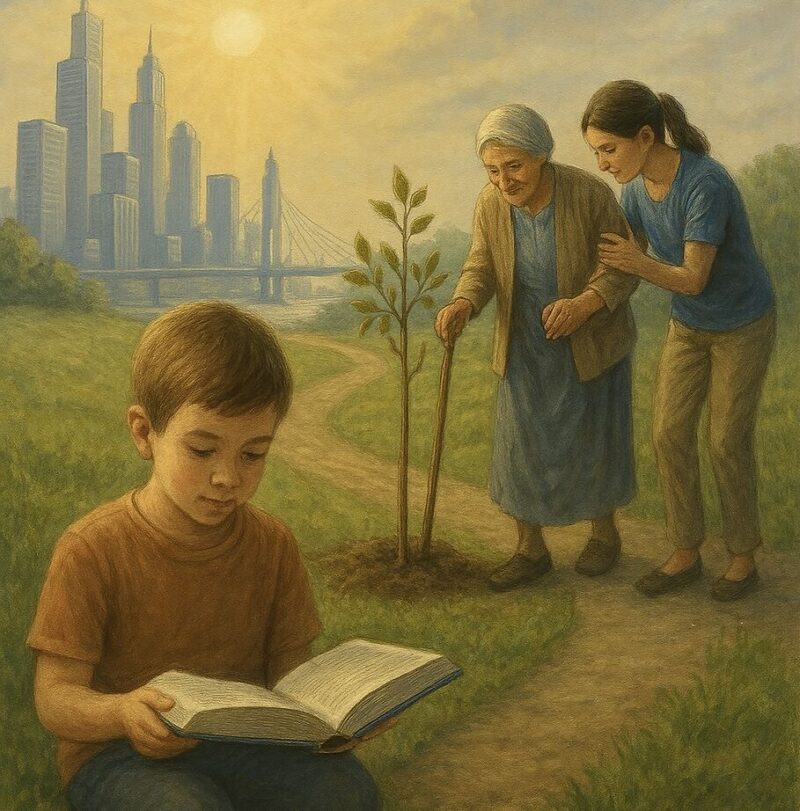Par le Dr. Ahmed Azough : Professeur-chercheur, Directeur du Master en Intelligence Artificielle à Paris
Modèles de moralisation à travers le monde : Comment certains pays ont-ils réussi à diffuser un comportement civique ?
Un ami me racontait avoir accompagné un migrant en situation irrégulière dans un hôpital en France pour des examens médicaux. Les médecins l’ont accueilli avec bienveillance, lui ont fait passer les analyses nécessaires, et lui ont même offert une opération chirurgicale coûteuse, sans jamais lui demander de papiers ni son origine. En quittant l’hôpital, le migrant leva les mains au ciel et pria pour eux : « Que Dieu les protège, ce sont eux les vrais musulmans ! »
J’ai également accompagné des chercheurs marocains en mission scientifique en Europe. L’un d’eux, ému par l’accueil chaleureux et le dévouement d’un fonctionnaire, voulut le remercier. Celui-ci répondit simplement : « Ne me remerciez pas, monsieur, je ne fais que mon devoir. »
De telles situations provoquent souvent chez le Marocain et le musulman un profond questionnement : comment se fait-il que des comportements que nous considérons « islamiques » soient parfois plus présents chez ceux qui ne revendiquent aucune foi, que chez nous-mêmes ? Cette contradiction nous invite à réfléchir aux mécanismes de la moralisation collective.
Dans le cadre de cette série, qui vise à accompagner l’essor urbain du Maroc d’une renaissance humaine, il est nécessaire d’étudier les modèles internationaux ayant réussi à implanter un comportement civique durable, pour en tirer des leçons adaptées à notre contexte sans pour autant les copier aveuglément.
Car si les grandes valeurs (justice, honnêteté, intégrité) sont universelles, les chemins pour y parvenir varient selon les cultures, les structures politiques, religieuses et social
es. Dans cet article, nous analysons les pays ayant obtenu plus de 50 % dans deux indicateurs clés : l’indice de perception de la corruption (CPI) et l’indice de la criminalité (Crime Index), en regroupant les modèles similaires pour mieux en dégager les grandes approches.
1. Le modèle de l’intégrité institutionnelle
(Scandinavie, Canada, Nouvelle-Zélande, Suisse)
Dans ces pays, l’éthique est portée par l’éducation critique, un fort sentiment citoyen et des institutions transparentes. Le comportement civique repose sur un équilibre entre la conviction intellectuelle (raison), la conscience intérieure (cœur) et l’autorité institutionnelle (État). La transparence est obligatoire dans les marchés publics, l’accès libre à l’information est garanti, et la confiance est indissociable de la reddition des comptes.
Si ce modèle génère une faible corruption et une criminalité réduite, il est parfois critiqué pour sa froideur institutionnelle, son excès d’individualisme et son besoin d’une base démocratique solide pour réussir.
2. Le modèle de la conscience collective
(Japon, Corée du Sud, Taïwan)
Ici, la honte est utilisée comme régulateur social positif : l’individu agit par respect du regard des autres plus que par peur des sanctions. Cela produit une éthique rigoureuse, observable dans le comportement public et l’engagement au travail.
Cependant, ce modèle peut générer des effets pervers : pression sociale extrême, isolement, burnout, baisse des naissances, et montée des suicides, car la tolérance envers les « moins performants » est souvent faible.
3. Le modèle du contrôle institutionnel
(Singapour, Malaisie, Hong Kong, Qatar, Émirats)
Dans ce modèle, la discipline est assurée par une forte autorité de l’État, l’appartenance religieuse et le patriotisme. Les citoyens respectent la loi plus par loyauté ou par peur des sanctions que par conviction profonde.
Ce modèle est efficace économiquement et socialement à court terme, mais il reste vulnérable à la dérive autoritaire et au délitement des valeurs si le pouvoir central perd sa légitimité ou sa rigueur.
4. Le modèle de la citoyenneté légale
(France, Allemagne, Espagne)
Ici, l’éthique découle principalement de la culture juridique : la loi est perçue comme l’expression de la raison publique. L’État de droit, la responsabilité et la liberté sont au cœur du système.
Cependant, en l’absence d’intériorisation émotionnelle des valeurs, l’éthique peut devenir purement formelle et froide, fragilisant la cohésion sociale et nourrissant l’individualisme.
5. Le modèle de l’intérêt individuel
(États-Unis, Royaume-Uni, Brésil)
Ce modèle valorise la réussite personnelle et l’initiative individuelle. L’éthique est souvent vue sous l’angle de l’efficacité professionnelle et du gain personnel, soutenue par un fort système juridique.
Mais l’accent mis sur la liberté individuelle au détriment de la cohésion communautaire génère des niveaux élevés d’inégalités, de criminalité et un affaiblissement de la solidarité.
6. Le modèle de la résilience communautaire
(Rwanda, Uruguay)
Dans ces pays, la moralisation est née d’une nécessité vitale après des traumatismes collectifs majeurs (génocide rwandais, dictature uruguayenne). La mémoire collective est utilisée pour reconstruire la confiance et l’éthique sociale.
Cependant, ce modèle reste fragile, car il dépend de la mémoire des blessures passées, dont l’influence peut s’estomper au fil des générations si elle n’est pas consolidée par des institutions solides.